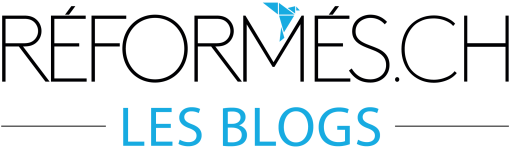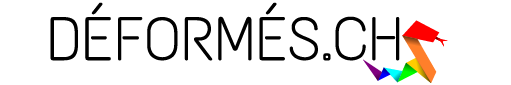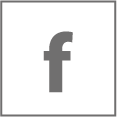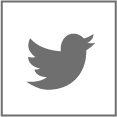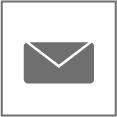Conduire l’Église vers ses périphéries
Décédé le lundi de Pâques, 21 avril, le pape François est surtout connu des protestants pour son encyclique «Laudato Sì», qui a donné un élan fondateur à l’écothéologie. Mais son legs consiste aussi en un approfondissement des réformes de Vatican II. Analyse par le théologien Pierre Gisel, qui a entretenu des rapports privilégiés avec cette figure centrale du catholicisme.
PARI Le pape François a poursuivi de façon décidée les réformes initiées par Vatican II, notamment au travers du Synode pour la synodalité. Il s’y est profilé au cœur d’un débat qui touche la réception du concile tout en renvoyant à des différences à l’œuvre au moment même du concile. Certains le cisèlent ainsi: aggiornamento ou changement de paradigme?
Un christianisme en mode opératoire
Le pari de François est de penser que ce qu’il en est de l’Église se joue sur ses frontières, non en se repliant sur ses réalités communautaires. Une Église «en sortie», comme il a aimé dire, ou s’articulant à ses «périphéries humaines». Périphéries au regard de son état institutionnel, mais où se tiennent les réalités et questions à prendre en charge. En ce sens, François poursuit une veine venant de Michel de Certeau (1925-1986). Il avait d’ailleurs dit, en 2016: «Pour moi, Certeau reste le plus grand théologien pour aujourd’hui.»
À l’arrière-plan, une vision du christianisme comme «opération» ou «geste» à inscrire dans le social. Un geste déterminé, certes, mais se nouant au cœur de ce qui fait l’humain et dont on ne saurait autonomiser la vérité en le renvoyant à un fondement extérieur, à répéter moyennant adaptations requises.
On aura beaucoup parlé des engagements de François à l’endroit des migrants ou autres marginalisés. De l’écologie aussi. Ou de la création, à laquelle il transfère l’image de maison commune qui, à l’origine, avait été mobilisée pour désigner l’Église. Cette maison commune dit notre condition de vivants, mais est aussi traversée de cultures plurielles. Ce que François a intégré comme jamais en catholicisme, voire plus largement.
Rapport à la création
Je pourrais déployer plus avant, mais vais me contenter de citer des passages de son encyclique Fratelli tutti de 2020. On pourrait y ajouter l’exhortation apostolique post-synodale Querida Amazonia [Amazonie bien-aimée] du 2 février 2020. Qu’il s’y agisse d’un ensemble transfrontalier et ne se trouvant pas à la pointe du développement moderne des techniques et du social est déjà significatif. S’y lisent en effet des modes de rapports au monde ou à la création autres que les nôtres. Des rapports non à répéter, mais instructifs.
Parlant des pauvres et des exclus à prendre en compte, François y ajoute régulièrement la défense des données culturelles dans lesquelles plonge l’humain. Dans Fratelli tutti, il s’oppose à «une globalisation» qui, visant «une uniformité unidimensionnelle», éliminerait «toutes les différences et toutes les traditions» ou détruirait «la richesse ainsi que la particularité de chaque personne et de chaque peuple». Il le fait à l’encontre d’un «rêve universaliste» qui finit par «priver le monde de sa variété colorée, de sa beauté et en définitive de son humanité» (pt 100) et tient qu’il convient de «s’enrichir réciproquement de la civilisation de l’autre, par l’échange et le dialogue des cultures» (pt 136).
Diversité et différences créatrices
L’encyclique avance que «l’universel ne doit pas être l’empire homogène, uniforme et standardisé d’une forme culturelle dominante unique». Il est «nécessaire d’enfoncer ses racines» dans l’«histoire de son propre lieu» (pt 144) et de reconnaître en même temps que «les différences sont créatrices» (pt 203). Rappelons que, lors de sa visite au Canada en juillet 2022, sur le fond du scandale des politiques d’assimilation et des années d’oppression à l’endroit des Amérindiens, il a parlé de génocide culturel alors qu’étaient en cause des politiques d’État liées à celles de l’Église, appuyées sur un double principe de civilisation et de mission catholique…
On est ici ailleurs que le texte de Lumen gentium souvent mis en avant au titre d’avancées de Vatican II, disant que l’Église est sacramentelle en ce qu’elle vise et condense l’«unité de tout le genre humain». Unité? Sur mode et visée totalisants? L’analogie convoquée m’a en tout cas toujours laissé songeur: «La communauté humaine, toujours plus étroitement unifiée par de multiples liens sociaux, techniques, culturels». Est-ce bien en effet une telle mondialisation qui doit être parabole de ce que le christianisme et l’Église ont à viser?
Historisons Vatican II: son temps fut celui d’un optimisme dont on est revenu. C’est que l’on mesure plus les effets pervers de visées alors centrales, pervers pour le monde et pour l’Église. Des visées probablement – assurément? – trop autocentrées.