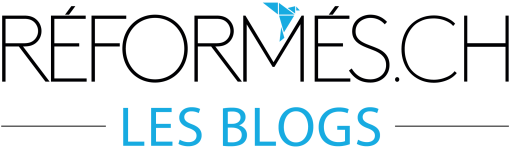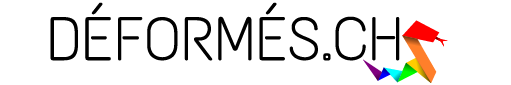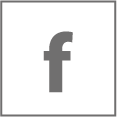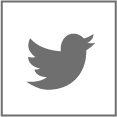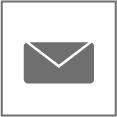La prépondérance de la force
«La raison du plus fort est toujours la meilleure», écrivait en 1668 l’homme de lettres français Jean de La Fontaine dans «Le loup et l’agneau». Plus de trois siècles plus tard, la prépondérance de la force au sein de notre société n’a guère vacillé. Du sport, où règne la quête du record, au monde de l’entreprise, où la performance s’évalue à l’aune de la productivité et du charisme, la puissance est constamment valorisée.
Sur les réseaux sociaux, elle s’incarne dans des images maîtrisées, exaltant corps sculptés et succès éclatants, reléguant la vulnérabilité au rang d’anomalie. Dès lors, faut-il s’y soumettre, la rejeter, négocier avec elle? Avant cela, il est essentiel de comprendre les raisons profondes de cette fascination, une question sur laquelle l’anthropologie apporte un éclairage précieux.
La force, l’idéal grec
Depuis l’Antiquité grecque, la civilisation occidentale demeure profondément marquée par l’idée d’une force maîtrisée, symbole de prestige et de supériorité. Dès le VIIIe siècle avant notre ère, à Olympie, les Jeux olympiques n’étaient pas de simples compétitions, mais se déroulaient dans un cadre ritualisé, étroitement lié au culte de Zeus. L’athlète victorieux y incarnait la suprématie de sa cité, transformant ainsi la performance sportive en un message politique et religieux. C’est cette dimension collective – au-delà de la simple performance individuelle – qui illustre la force de l’idéal grec. On y exalte la vigueur non seulement pour l’individu, mais comme un pilier identitaire pour toute la société. Jusqu’à aujourd’hui, dans nos représentations collectives, la puissance reste synonyme d’excellence et de succès.
Contrôle de soi
Un autre héritage: la philosophie grecque, qui a largement contribué à forger la figure du sage capable de canaliser ses passions pour atteindre le bien. La quête d’«arété» – la vertu au sens de l’excellence humaine – est devenue la boussole de nombreuses écoles philosophiques, du stoïcisme à l’aristotélisme, toutes unies par l’idée qu’il fallait brider la vulnérabilité, jugée dangereuse et immorale.
D’autre part, si l’on pense aux récits épiques d’Homère ou aux tragédies d’Eschyle et de Sophocle, on voit combien la question de la faiblesse est presque toujours mise en tension avec l’honneur et la responsabilité sociale. Cette tradition – qui a érigé le contrôle de soi en idéal – continue d’imprégner nos représentations modernes, qu’il s’agisse de la réussite économique, du culte du corps performant ou de la consécration sociale. Tandis que la vulnérabilité était souvent associée à l’esclavage, à des figures marginales, aux étrangers ou à la maladie.
L’attention aux plus faibles
Paradoxalement, la tradition chrétienne, qui imprègne pourtant profondément l’Occident, a porté un message radicalement différent. Au centre de la foi chrétienne, on trouve le Christ en croix, qui incarne une vulnérabilité assumée, revendiquée comme chemin de salut. Les Evangiles valorisent l’attention aux plus faibles, l’acceptation de nos limites et la solidarité. Mais au fil des siècles, la figure du Christ souffrant a parfois été éclipsée par celle du Christ-Roi, tout-puissant. Cette tension entre force et fragilité se retrouve donc aussi dans la culture chrétienne, révélant une ambivalence profonde face à la faiblesse. Et si la force est un moteur de réussite et de progrès, elle peut aussi devenir un tyran lorsqu’elle exclut toute faille. L’anthropologie souligne la manière dont chaque culture négocie avec la question de la puissance. Elle nous rappelle que les représentations peuvent être repensées pour construire une société où l’on cultive à la fois l’excellence et la bienveillance.